Pour
avoir moi aussi accordé trop de confiance à ma ligne de vie et à mes
livres à venir, j’ai découvert à mes dépens la trouble
félicité d'un tel enlisement. Il m’avait semblé pouvoir tout mener
de front – la préparation de mes cours, la rédaction d’articles et mes
responsabilités familiales – et simplement différer un
peu l’écriture des textes dont je me sens depuis longtemps porteur.
Je m’y suis esquinté pendant quelques années, puis me suis rendu compte
qu’à fonctionner en surrégime permanent je ne pouvais
que bâcler mes travaux, empiler mes notes sans jamais en utiliser
correctement la substance, et ajourner jusqu’à mon dernier souffle la
rédaction de mon grand œuvre consacré aux frontières entre
les genres musicaux. Tout en éparpillant mes idées au fil de courts
articles comme Jean-Germain Gaucher gaspillait ses trouvailles
mélodiques en chansonnettes, j’attendais le moment où ce corpus
préparatoire prendrait de lui-même sa forme et coulerait de ma plume
comme l’eau d'une fontaine. Ma paresse prolongerait même au-delà de
toute raison l’idée qu’à trop vouloir hâter ce miracle je
risquais d’en compromettre l’avènement. Jusqu’au jour où, comme il
devenait évident que cette procrastination ne donnerait jamais de fruit,
je me suis résolu à lui imposer l’épreuve de
réalité : l’occasion se présentait de prendre trois mois de congé
sabbatique, et un collègue me proposait sa maison de campagne, il
m’était difficile d’esquiver. Ma première semaine s’est
passée à transporter mes documents et une caisse de livres, à ranger
mon attirail pour m’installer un bureau d’écrivain, et à essayer de
rassembler mes idées face à ma ramette. Le vendredi soir,
la culpabilité de ne pas avancer dans ce travail alors qu’Agnès
assumait seule la charge des enfants m’a poussé à rentrer pour le
week-end à la maison, où ma nichée a voulu savoir combien de
chapitres j’avais écrit. Le lundi matin je suis retourné à mon
écritoire comme on retourne à la mine, exténué à la pensée d’en extraire
fût-ce une esquille. Comme il me fallait relire des
centaines de pages plus ou moins oubliées, reprendre mes
annotations, les comprendre et les nuancer, j’estimais judicieux
d’ouvrir mon chantier par du rangement informatique, de sorte que je
perdis plusieurs journées à saisir et à classer des citations, des
notules et des idées directrices jusqu’à m’aviser que cela ne m’avançait
à rien. Le week-end suivant, c’est Agnès et les enfants
qui débarqueraient pour me distraire de ma solitude et de mon
ouvrage, dont je ne pouvais toujours pas présenter la moindre ébauche.
Et, de semaine en semaine je découvrirais que, malgré la
clarté de mon projet, il me manquait toujours un dictionnaire, une
référence, et surtout le bon angle d’attaque.
Emmanuel Venet, Rien, Verdier, 2013, p. 88-89.
Je ne résiste pas à mon envie de citer un extrait de l’autre Rien, car il y en a un autre, signé Emmanuel Venet, et
paru chez Verdier à l’automne dernier. Il résiste aussi pourtant, ce Rien
d’Emmanuel Venet, à l’artificielle pratique de l’extrait, tenu qu’il
est d’un bout à l’autre en un seul et
fluide paragraphe. Jean-Germain Gaucher est le sujet du narrateur
qui est le sujet de l’auteur, c’est-à-dire ce rien qui aurait pu être
quelque chose s’il n’était passé à côté, faute de muflerie
ou d’égoïsme qui sont les autres noms du courage. La coïncidence des
titres est donc sans doute un signe, et je remercie chaleureusement
l’excellent prescripteur qui a pris le temps de m’écrire
exprès juste pour me dire qu’il avait pensé à moi en lisant Précis de médecine imaginaire du même Emmanuel Venet et que je n’ai suivi qu’à moitié lorsqu’en me penchant sur la question
j’ai vu que le dernier livre de l’auteur s’intitulait Rien.
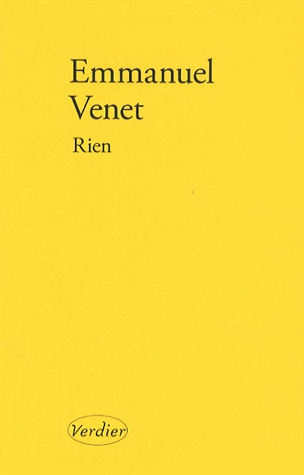

Je crois que tout cela est du vécu, et c'est bien là que réside l'art de la fiction ! La prochaine fois, tu mettras comme titre "Quelque chose", et on saura que c'est de toi !
Et donc Rien en commun. Oui. Non. Mais si.
Ou peut-être que si ?