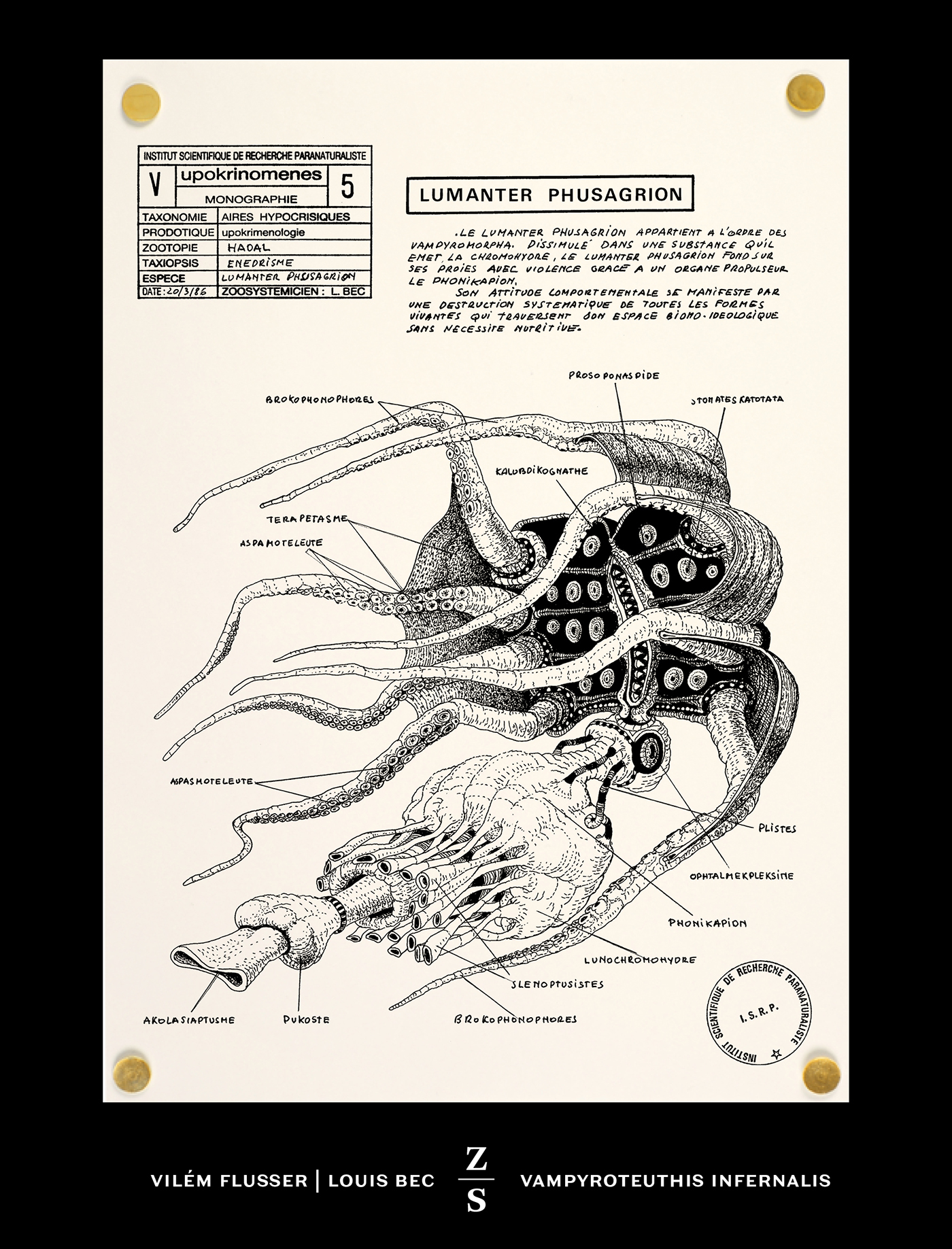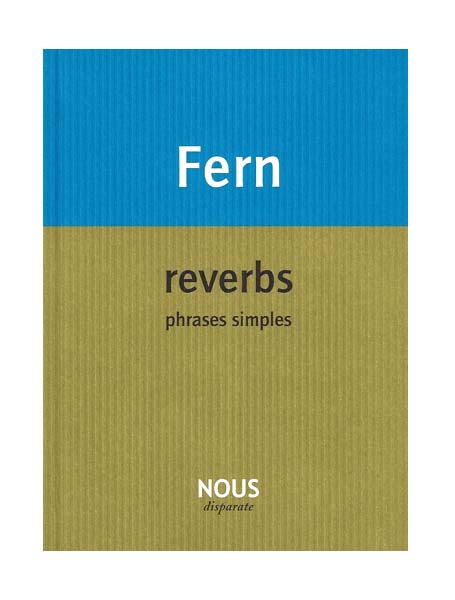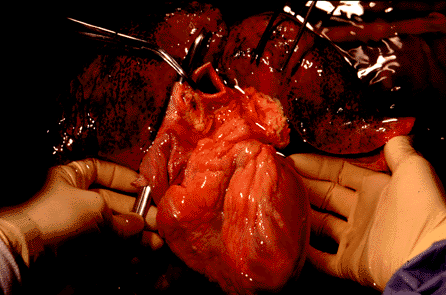Cet article a été publié en 2011 sur le site MéLiCo, mémoire de la librairie contemporaine.
Il faut bien le choisir, l’appât,
se dit le pêcheur, asticot ou mouche de plume ; moi je n’y connais rien,
dommage, pas étonnant que ça ne morde pas davantage. Car c’est bien à ça que ça
sert, trop souvent, le sujet – pas vraiment le sujet, non, mais l’idée qu’on se
fait du sujet : un appât pour le public, portrait du lecteur sur
l’étalage du poissonnier, choisissez votre espèce, il y a encore de la variété.
Je ne vais pas faire un
catalogue, pas le temps, mais propose volontiers le pensum à qui veut bien. Je
vais juste développer un peu ce que je disais ici même il y a deux mois.
Je me souviens de la Ligne
de Pierre Bergounioux et je ne doute pas que le pêcheur pêche des illusions (c’est
pour ça aussi que je ramasse les champignons) : le poisson ni même la
pêche n’y sont vraiment le sujet.
Le sujet est toujours ailleurs.
Pourtant, les livres, toujours ou
de plus en plus, je ne sais pas, sont vendus sur, par, pour leur sujet. Sujet à
scandale-potin des popotins, sujet douloureux de société pour donner la parole
à ceux qui ne l’ont pas, sujet grave de notre Histoire qui, c’est pratique pour
l’auteur, rendent le livre indiscutable-rangez-vos-critiques – font souvent les
succès de librairie, qui masquent (alors qu’au fond ils ne font qu’illustrer)
la crise de la représentation de la littérature aujourd’hui. (Je ne dis pas
« d’aujourd’hui » : j’ai l’impression que c’est vrai encore
aujourd’hui de celle d’hier.) Les sujets sont là, bien alignés en rayon, il n’y
a qu’à choisir. J’ai tendance à penser que c’est quand même une facilité, ces
sujets extérieurs, préexistants. Même si bien sûr ça n’empêche pas que certains
s’en tirent avec les honneurs.
Ça en fait beaucoup des livres
que je ne lirai pas – alors que peut-être on ne m’a simplement pas dit ce qu’il
aurait fallu (argument du genre « un écrivain qui a quelque chose à
dire »).
On m’objectera Federman tout de
même, qui nous raconte sa vie, cette histoire épouvantable et ce parcours
étonnant… Eh bien non, je m’en souviens de sa bouche : réfutant avec
simplicité la singularité de son destin ; des histoires comme la sienne
hélas il y en a eu plein. Son sujet est moins sa vie que la vie – d’ailleurs on
n’a jamais autant envie de vivre qu’en sortant d’un de ses livres – et la vie
est bien plus que son sujet.
J’ai lu parfois que mon Liquide
avait pour sujet la vie de couple et la filiation, après tout ça en parle.
Pourtant au lieu de le faire quitter par sa femme, mon personnage, j’aurais aussi
bien pu le mettre au chômage ; pour moi ça n’avait pas grande importance,
ça n’aurait pas changé le sujet. Ça aurait juste changé l’histoire, en
surface. L’histoire, c’est encore la forme. Et je serais devenu un écrivain du
travail, comme mon voisin de résidence, Thierry Beinstingel, tiens.
Que je salue d’autant plus que le
voici qui vient donner de l’eau à mon moulin. Des années de voisinage, pas sur
Mélico mais à la Fête de l’Huma m’ont donné l’envie de lire ses livres, allez-y
c’est du bon. N’empêche qu’il a fallu que son fil tendu par lui depuis des années
croise l’actualité d’Orange pour qu’on se dise que tiens, c’est vraiment bien,
ça, on va le mettre dans la sélection du Goncourt. Alors que le sujet de ce
livre, je parle de Retour aux mots sauvages, ce n’est pas du tout
l’actualité d’une société, c’est plutôt l’effacement de l’identité, de
l’humanité, par le travail d’aujourd’hui – et la résistance de l’humain malgré
tout. Au moins ça. C’est quand même dommage qu’il y ait toujours un petit bout
de lorgnette dans les origines d’un succès, même quand il est mérité.
On en revient toujours à
ça : il faut que le prescripteur ait quelque chose à dire, sur le
livre. Allez donc vendre un prétendu roman sur les insaisissables altérations
du ciel et de l’humeur, dont le pitch se limite à peu de choses près à une
promenade le nez en l’air – ça existe : ça s’appelle l’Automne zéro
neuf de Didier da Silva.
Oui, je m’étais fait une petite
liste d’œuvres chères dont j’avais envie de parler, à propos de cette fichue
question du sujet. Il y avait la série des Faits aussi, de Marcel
Cohen ; tant pis, je suis déjà long, j’en aurais d’autres encore à citer,
dont je parle aussi ailleurs.
Et puis d’accord, ce n’est pas
franchement nouveau, cette méfiance à l’égard du sujet ; ça a déjà été dit
bien mieux, et depuis longtemps. Ça remonte au moins à Flaubert. Ou à Sterne.
Ou à qui vous voudrez. N’empêche que ça reste encore le principal argument de
vente. Et comme on a conscience de l’insuffisance, on rajoute un mot sur le
style. Comme si le style, c’était un truc que l’écrivain rajoute, quand il en a
les moyens. Une sorte de veste Kenzo ou Armani. Inutile de préciser (pourquoi
je le fais ?) que je vois les choses autrement. Faites-moi donc penser à
en parler la prochaine fois, du style. Ou du genre, aussi. C’est vrai : il
n’y a pas que le sujet, quoi.