La
plupart du temps, je suis seul. Je ne sais plus qui a dit qu’entre le
transfert et la solitude, il fallait choisir. Eh bien
moi, je n’arrête pas de transférer et pourtant je suis seul. Par
exemple, mon vélo est à l’évidence non seulement une partie de moi-même
mais moi-même quand je suis sur mon vélo, car il ferait
beau voir que je finasse à ce propos en pleine course sur une
nationale surembouteillée où les conducteurs ne font pas plus cas de
vous que d’un hérisson, et il ferait beau voir également,
lorsqu’un conducteur me passe et donc ne fait pas plus cas de moi
que d’un hérisson, que je ne sois pas illico l’arbre qui se présente et
qui risque de brutalement me rencontrer, pour tout
aussitôt devenir, au moment même de l’impact, le pauvre moucheron
qui s’est précipité dans mon œil, le chauffe et le rougit, puis le petit
chien qui s’accroche à mon bas de pantalon en jappant,
comme je comprends qu’il veuille jouer : je joue avec lui tout en
faisant mine de secouer ma chaussure ; c’est, en tant que grande
personne, l’attitude que j’attends de moi ;
alors, un peloton de cyclistes m’encadre (voir supra) et je suis
cycliste, le peloton s’éloigne et je suis orphelin, mon papa est mort et
maman m’a abandonné quand j’avais quatre ans, j’ai été
placé en famille d’accueil, les services sociaux se sont trompés
dans mon dossier et ma mamy de substitution n’a pas touché sa pension,
je mange des omelettes aux petits pois tous les jours mais
je suis entouré d’affection, mes vêtements sont achetés sur le
marché et à l’école les camarades se moquent de moi en se montrant leurs
Nike et en me criant jeusdouit, jeusdouit, pendant toute la
récréation, alors je me réfugie dans la classe près du cochon d’Inde
et la maîtresse m’asticote : allez, il faut pas se laisser faire, va de
l’avant, retourne dans la cour, c’est là que ça
se passe ; je retourne dans la cour pour lui faire plaisir et je
m’appuie au mur en attendant la sonnerie ; le lendemain j’ai une crise
d’eczéma, mes joues sont rouges et pleines de
croûtes, je suis obligé de me soigner au Mercryl Laurilé qui est un
liquide qui pique, à ce moment j’évite un trou, et je suis, bien
entendu, le temps que je le borde, ce trou, ce défaut de
voirie dans un continent sans argent, à la pensée continentale,
vieille et dévoyée, et je suis moi-même cette pensée fripée, ce goût
nouveau pour la pierre de raille, le vin rouge et les
allocations familiales, puis, tout au bout de la route, il y a ce
point qui ne cesse de fuir et je suis ce point qui ne cesse de fuir et
reste égal à lui-même le temps que je pédale.
Nathalie Quintane, Cavale, POL, 2006, p. 127 à 129.
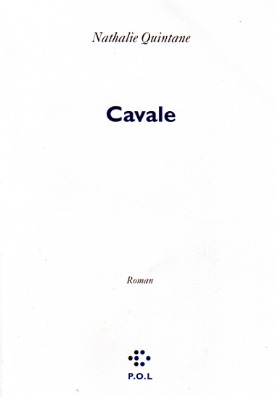
La lecture de Guillaume Fayard sur Sitaudis.
Commentaires
Ah ! Après Tomates - c'est ça? - j'ai comme dans l'idée que je vais retrouver la Nathalie Quintane que je préfère.
Commentaire n°1
posté par
Depluloin
le 18/06/2012 à 19h01
Avant Tomates, plutôt, mais déjà en cavale.
Réponse de
PhA
le 18/06/2012 à 19h06
Magnifique ! On pense à l'écuyer "surexistant" du chevalier inexistant de Calvino...
Commentaire n°2
posté par
Fiolof
le 20/06/2012 à 00h44
Finalement l'existence n'est qu'une longue hésitation entre sur-existence et sous-existence.
Réponse de
PhA
le 21/06/2012 à 11h20
