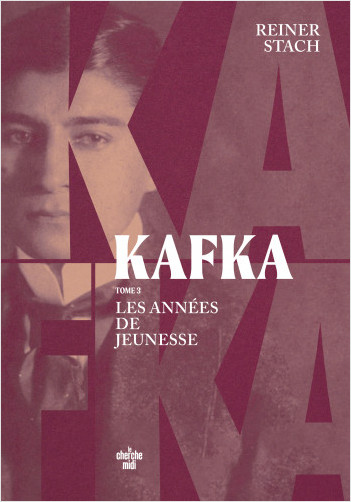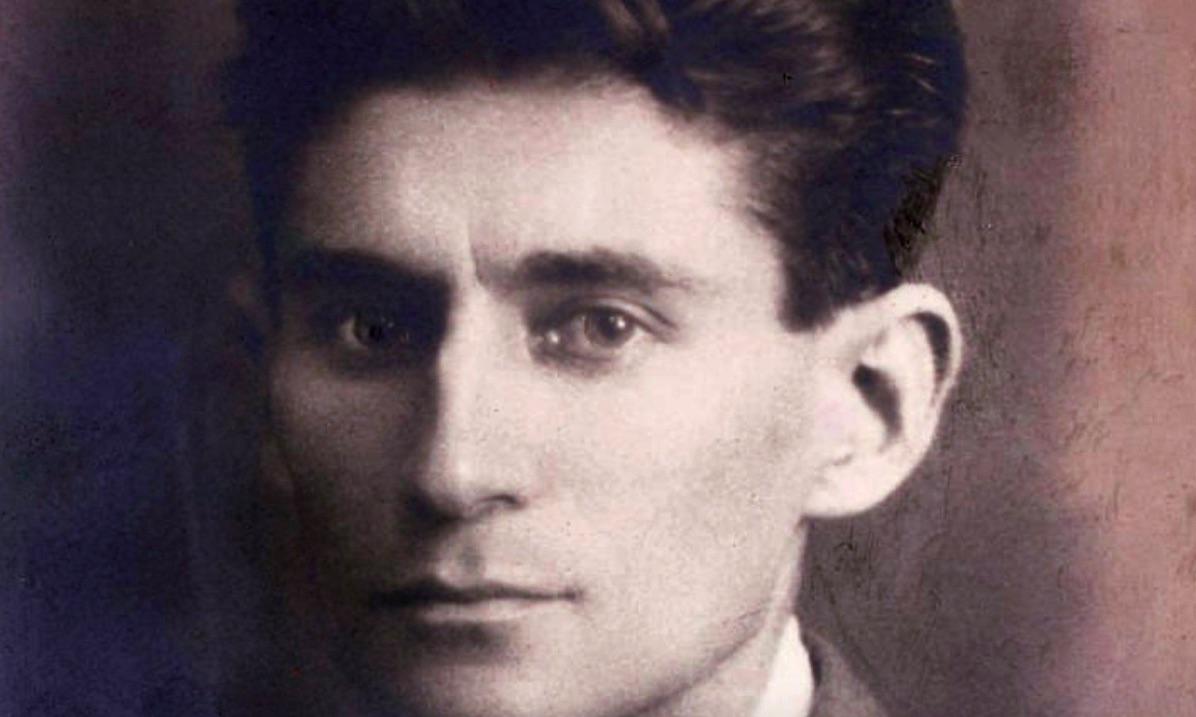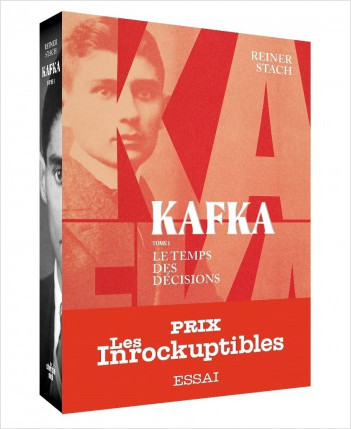Un extrait de la biographie de Kafka par Reiner
Stach, qui donne à penser, et à penser encore :
« Kafka
voulait encore plus qu’une clôture du texte sur lui-même, il
voulait la « conclusion innée », celle qui
s’anime déjà tel un fœtus sous la surface de la toute première
phrase et qui affirme peu à peu ses contours. Il est permis de se
demander si ses projets de roman admettaient bel et bien la
possibilité d’une telle unité intérieure, ou, pour poser la
question jusqu’au bout, s’ils pouvaient seulement être
achevés, s’ils n’étaient pas plutôt condamnés dès l’abord
à rester à l’état de fragments. Après tout, cette incapacité
éternelle à atteindre le but qu’on s’est fixé n’est pas
seulement ce qui affecte, mais aussi ce que décrit, le romancier
Franz Kafka ; le jeune « disparu » s’éloigne
du côté sûr de la société américaine à mesure même qu’il en
rêve ; le tribunal suprême reste invisible aux yeux de
l’accusé Josef K. ; les autorités du château, inaccessibles
à l’arpenteur. Ne pourrait-on pas imaginer – même si cette idée
n’a sûrement jamais effleuré l’esprit de Kafka – qu’une loi
secrète ait amené l’auteur à reproduire l’échec de ses
héros ? Qu’il ait atteint une unité esthétique supérieure,
qu’il se soit justement rapproché de la perfection rêvée en
n’achevant pas ses romans ?
Thèse
séduisante, notamment parce qu’elle constitue un paradoxe on ne
peut plus « kafkaïen » et que l’auteur – s’il
avait eu le plaisir d’assister à un séminaire consacré à son
œuvre – aurait même pu la trouver à son goût. Sa faiblesse est
qu’elle sous-estime le potentiel du roman moderne, qui vit
précisément d’une galvanisation mutuelle de la forme et du
contenu. Les romans de Beckett sont sans aucun doute des objets
achevés qui témoignent d’une grande confiance formelle – et
cependant, ils ne parlent de rien d’autre que de fragmentation, de
décomposition et de déchéance. Le babillage redondant de ses
personnages, les lambeaux de pensées qui s’allument dans leurs
cervelles solipsistes avant de s’effilocher et de disparaître sans
laisser de trace – tout cela est le fruit d’un art du verbe
extrêmement raffiné. Et on ne gagne rien à objecter qu’il ne
s’agit plus de romans. Car Beckett tire les conséquences d’une
évolution engagée longtemps avant lui dans le roman européen :
la perte de cohérence entre perception interne et externe, le
travail de sape qui affecte cette unité douteuse qu’on appelle le
« moi ». Et dans ce maëlstrom, où faire passer la
limite historique au-delà de laquelle le roman cesse d’être
roman ? Dans La Faim de Knut Hamsun ? Dans Le
Procès de Kafka ? Dans l’Orlando de Virginia
Woolf ?
Un
roman qui parle d’échec n’est pas forcé d’échouer, et les
moyens dont dispose l’auteur pour réfuter ce simplisme
psychologique sont, heureusement, infinis. C’était l’évidence
même aux yeux de Kafka – et jamais il ne lui vint à l’esprit
que sa mystérieuse inaptitude à terminer ne serait-ce qu’un seul
de ses trois grands projets pouvait avoir un lien avec leur sujet ou
leur structure. »
(J’imagine
Kafka lisant Beckett et lui confiant : « vous ratez mieux
que moi ».)
(Tiens,
je n’avais pas vu que déjà paraît le second tome de cette
formidable biographie alors que j’en suis à peine à la moitié du
premier.)