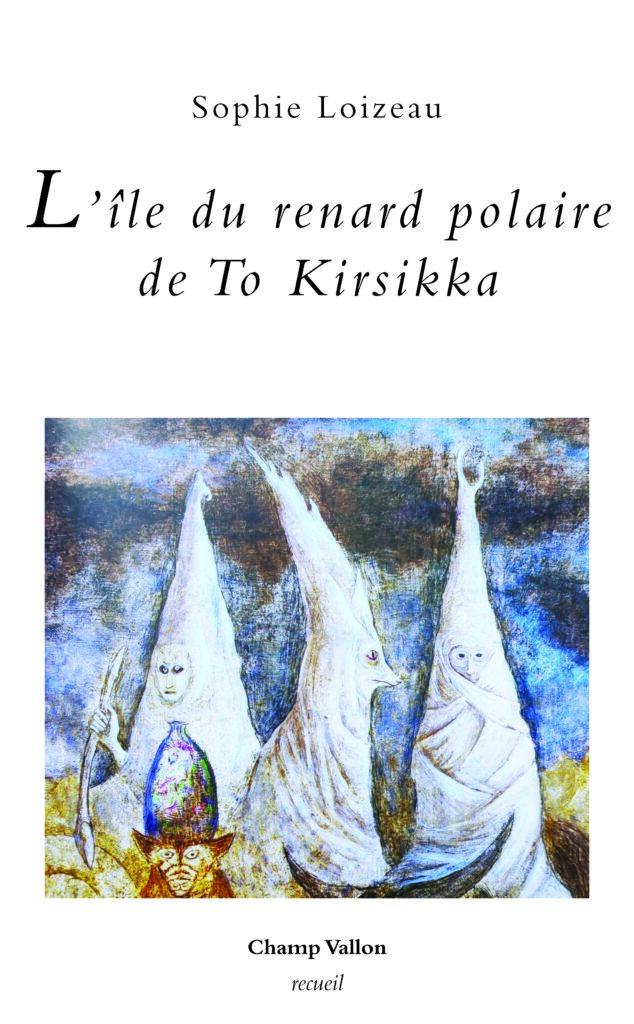Attention,
le titre de ce billet est trompeur – et peut-être d’autant plus
éclairant.
Quand
j’ai vu que Guy Bennett avait publié un nouveau livre (il est paru
en janvier aux éditions LansKine, on ne m’avait rien dit, il me
faudrait un secrétaire chargé de m’informer de tous les livres
qui paraissent et qui ont des chances de m’intéresser, il aurait
du travail, non pas que ces livres soient si nombreux, mais parce
que, comme c’est écrit en-dessous de ces Hublots « la
visibilité est mauvaise), je suis passé à la librairie de la ville
où je travaille (les habitants des Essarts-le-Roi sont de sacrés
veinards, ils ont une vraie librairie pour eux, c’est rarissime
pour une commune francilienne de cette taille) pour le commander.
Bien
sûr j’avais déjà dans l’idée, après lecture, d’écrire un
petit billet dessus, comme je l’ai déjà fait pour Poèmes évidents, Ce livre, Œuvres presque accomplies, et
Remerciements, tous du même Guy Bennett dont, on l’aura
compris, le travail m’intéresse au plus haut point. Qui plus est,
En exergue (c’est le titre de ce nouveau livre) est paru aux
éditions LansKine où doit paraître mon petit prochain (mais chut).
Qui plus est, En exergue (c’est le titre de ce nouveau
livre) est, ou était, car j’en ai lu la quatrième de couverture
avant d’ouvrir le livre, « une méditation sur l’usage et
l’abus des citations dans le discours, dans la littérature, dans
la vie ». Lesquelles sont la matrice même d’En exergue.
Elles y sont comme il se doit placées en exergue, l’une toutefois
plus que d’autres, puisqu’elle est en exergue de tout le livre En
exergue même – on ne s’étonnera pas de la devoir à
Borges : « Je constate avec une sorte de mélancolie
douce-amère que tout au monde me ramène à une citation ou à un
livre. » Certaines sont tellement dignes d’être en exergue
qu’elles ne le sont pas : en gros caractères, elles
remplissent leur propre page, nous laissant à penser que c’est à
nous de penser.
Car
les autres vont par paire, se répondant, se faisant écho ou faisant
mine de s’opposer ; et c’est cette paire même – une
citation en regard d’une autre – qui donne matière à la
réflexion de l’auteur, dans un commentaire également double :
x par rapport à y, y par rapport à x.
Et
voici que, dès la page 11, après un développement généré par la
rencontre sur une page de Guy Bennett de deux réflexions sur ce
qu’est l’écriture respectivement de Marguerite Duras et Claude
Roy, en vient un autre, inspiré sur le même sujet (qui l’est
toujours sans jamais l’être jamais, c’est juste l’infini ce
truc) par Laure Limongi et Eve Sauze-Chapel. Or, là où l’on
n’attendait que le dialogue entre ces deux dernières, voici que
vient s’insérer une parenthèse (au diable ces parenthèses !)
dans laquelle s’ouvrent des guillemets : on y lit une autre
citation encore, laquelle n’est pas en exergue, c’est une petite
esseulée, ou une petite bien entourée. Je vous recopie cette
parenthèse, en voici une au moins qu’on ne pourra pas m’imputer :
« (comme
Philippe Annocque l’a remarqué, « Écrire, c’est lire
avant même que ce soit écrit ».) »
Oui,
vous avez bien lu : il semblerait que l’auteur de cette
citation soit aussi l’auteur de ce billet. J’écris « il
semblerait » car j’avoue ne plus savoir où j’aurais écrit,
ou prononcé, cette phrase, ni même si elle est vraiment de moi.
Mais comme j’ai par principe toute confiance en l’auteur, je fais
confiance à Guy Bennett : cette citation doit être de moi.
D’ailleurs, si je m’interroge, je dois bien reconnaître qu’elle
pourrait l’être. Je pourrais très bien avoir écrit « Écrire,
c’est lire avant même que ce soit écrit ». Cela correspond
à quelque chose que je pense, ou que je sens. Dès lors, pourquoi
cet instant de doute (indépendamment du fait que je doute de tout ce
qui me concerne – mais cela ne concerne que moi) ? C’est
très certainement, c’est indiscutablement lié à la pratique même
de la citation. On extrait une phrase de son contexte (mais si on le
fait, c’est parce que l’auteur lui-même a rendu possible cette
extraction ; l’auteur a préparé dans son texte les citations
potentielles – certains même le font d’une manière un peu
pathétique), j’ai rendu possible cette extraction. La citation est
une phrase qui n’est plus vraiment de l’auteur qui l’a écrite ;
elle est presque davantage de l’auteur qui la cite – du moins
est-ce ainsi que je vois les choses quand je me vois cité. Plus
encore, la citation, avec cette forme aphoristique qui la caractérise
souvent, a été, consciemment ou non, écrite pour être détachée
de son contexte, pour être citée. Le présent gnomique, l’emploi
d’un déterminant à valeur générale, tout cela détache la
future citation de la singularité du texte. C’est une phrase
démontable prévue pour l’usage commun.
Ce
billet est déjà démesurément long, aussi m’arrêterai-je ici,
alors que je n’ai encore rien dit ou presque d’En exergue.
Ou peut-être que si ? Lisez-le et dites-moi.