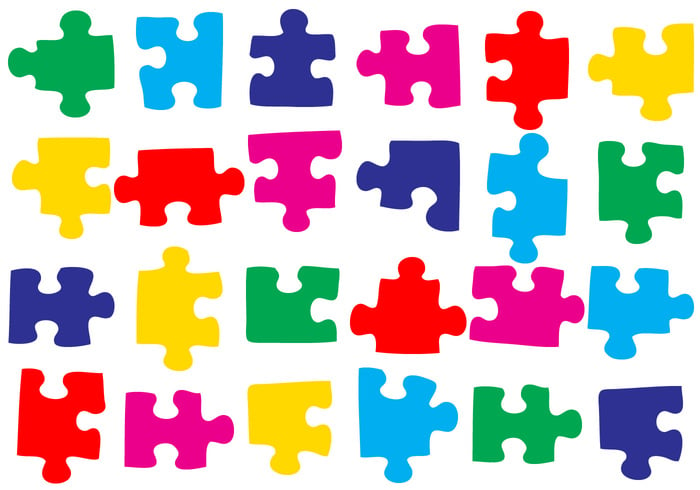Je commence peut-être à savoir à qui envoyer mes textes. Le
problème, c’est que les éditeurs veulent l’auteur, et le bougre
est difficile à cerner. Colette Lambrichs avait aimé Chroniques
et demandé à voir un autre texte, Liquide ne l’a pas
convaincue (j’avais oublié ça) ; après lecture de Par
temps clair et Une affaire de regard, elle finit par
renoncer. Bertrand Fillaudeau, des éditions José Corti, m’écrit
à la main un refus très encourageant, qui me réchauffe le cœur.
Je crois que c’est lui qui me parle, lorsque je passe récupérer
le manuscrit (c’est cher, ces trucs) et qu’on discute un peu, de
la réticence des éditeurs indépendants à publier un auteur qui a
déjà été publié chez un gros ; ils préfèrent faire leurs
propres découvertes. Je comprends ça très bien. Ma publication au
Seuil est devenue plutôt un obstacle, je ne fais plus envie. Ce
n’est pas moi qui devrais faire envie, ce devrait être mes
textes ; mais on vend les auteurs avec les textes. C’est un
peu la faute du public aussi, les gens aiment (ou n’aiment pas) la
personne de l’auteur. Alors que quand il s’agit juste de lire, on
devrait s’en foutre. Bref, ça me rend difficile à publier,
indépendamment même de ce que j’écris. Gérard Bobillier, pour
Verdier, m’envoie le refus le plus étonnant de toute ma
collection ; j’en suis presque aussi fier que s’il l’avait
pris ; lisez plutôt :
« Paris, mercredi
14 avril 2004
Cher Monsieur,
Nous avons lu avec
intérêt Chroniques imaginaires de la mort vive, le
chant de cet homme de retour en son village d’enfance, Moustier,
que sépare de Vauvert un bois. C’est un lieu minuscule que
l’imaginaire de l’enfant rendait infini : les hommes
visibles, la Bête invisible et la princesse inaccessible. Le lieu
que retrouve l’adulte est tout aussi insaisissable : les morts
se succèdent et face à ces morts, le silence de la meute des
hommes. Ils ont perdu le pouvoir de dire. Les mots, vidés de leur
substance, se murmurent comme des litanies. Le narrateur lui-même
ignore ce qui le rend désormais étranger à ces gens et à
lui-même, sans nom propre. Il s’interroge sur ce qui meut la
langue : « La mort de Marie avait fait taire Vauvert,
celle de François lui avait rendu la parole. » L’ennemi
commun surgit sous le nom du Malin dans la bouche des femmes ou du
loup, selon la nécessité du langage commun.
Derrière le silence,
il y a les soldats inconnus sans sépulture et derrière encore, la
mort de Dieu, dont la lumière chue nappe indifféremment les objets.
La mort du maître, du roi, livre les hommes à la « volonté
lubrique et rigolarde de leur membre », en toute impunité.
Et derrière la
princesse inaccessible, il y a l’étreinte du corps de Mina aux
mains sales, la desservante d’Hécate. Cette étreinte n’abolit
pas la différence sociale qui, fixée dans son inaccessible origine,
est éternelle. La goutte visqueuse luit du mystère éternel de «
l’origine de la vie dans l’ombre », la semence de trop, que
l’on essuie. La mort de Mina replace l’homme à la tête de la
meute des chiens, à charge de nommer.
Le récit, maintenu par
l’imparfait et le plus que parfait dans un temps quasiment
immobile, se situe aux limites de l’indicible.
Ses qualités font
qu’il devrait sans peine trouver son éditeur.
Bien à vous.
Bobillier »