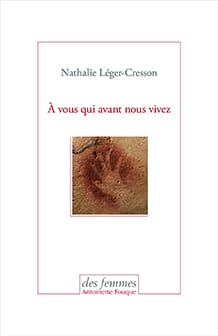Je veux écrire un billet
sur le nouveau roman de mon ami Didier da Silva. Qu'il soit un
ami n'est pas tout à fait anodin, je parle de ma lecture, de comment
je le lis après avoir lu tous ses autres livres, depuis le premier,
Hoffmann à Tokyo, y compris tous ceux qu'un peu coquettement
il renie, je le reconnais bien là ; et jusqu'à L'ironie du
sort, il n'y a pas si longtemps, laquelle marque un tournant, j'y
reviendrai.
Ma phrase n'est pas tout
à fait aussi da silvesque que je la souhaiterais, elle filandre un
peu, pardon Didier ; et puisque c'est moins ton livre que ta
phrase que je veux évoquer, ou du moins lui à travers elle d'abord,
j'ouvre celui-là au hasard, et y recopie celles-ci :
« Il avait beau
tenir ces propos décousus dans un français parfait, elle [vous
aurez reconnu l'armée française, note d'Annocque] ne songeait
certainement pas à prendre à son service un jeune Prussien à l'air
hagard, s'il vous plaît, monsieur, circulez, et c'est une faveur
qu'on vous fait. La providence lui sauva la mise en mettant sur son
chemin un jeune médecin-major croisé à Paris en 1801, à la
faculté ; prenant le pouls de la situation, le brave garçon
l'abrita chez lui, en qualité de domestique pour la galerie, avec
défense expresse d'en sortir ; il avait eu une chance de damné
en n'excitant pas davantage la méfiance des autorités, on en avait
déjà fusillé pour moins que ça et récemment encore un de ses
compatriotes, pris pour un espion russe, avait été passé par les
armes. »
Les grammairiens n'auront
pas manqué de remarquer la tendance de la phrase da silvienne à la
parataxe, les stylisticiens parleront plutôt d'asyndète, va pour
asyndète car c'est bien du style que je parle, c'est bien du
style que je pars. Il y a dans ces phrases, telles qu'elle naissent
sous la plume de l'auteur, un effacement de la subordination qui
amène le lecteur à mettre tout ou presque sur un pied d'égalité.
Or ce qui moi me fascine, c'est la parfaite cohérence, peut-être
légèrement inconsciente mais je ne désespère pas, que dis-je,
j'ambitionne carrément de faire découvrir à l'auteur quelque chose
sur lui-même, la parfaite cohérence disais-je entre cette
caractéristique de la phrase et l'ambition même du roman – sur le
plan macro-structural, aurais-je osé proclamer il y a une trentaine
d'années, quand ces vocables-là étaient encore à la mode. Car, de
la même façon que nous avons dans la phrase de Didier une
juxtaposition de propositions entre lesquelles le lecteur est invité
(et non pas contraint) à restituer les rapports, Toutes les
pierres (c'est son titre, il est magnifique et encore plus après
lecture, vous comprendrez pourquoi je ne l'ai pas cité d'emblée)
nous raconte conjointement la vie du poète Li Baï qui, citons sans
vergogne la quatrième de couverture, « arpenta la Chine du
VIIIe siècle », et celle du « terrible Heinrich von
Kleist, mort très jeune en 1811 ». Et bien évidemment
l'invitation précitée, à restituer les rapports entre les
propositions de la phrase, vaut aussi bien au niveau supérieur des
récits – car il y en a plusieurs, qui alternent, ou non, selon les
changements de chapitre. En musicien qu'il est (et que je ne suis
pas, vous me pardonnerez les approximations), Didier sait qu'un motif
vaut par la confrontation avec un autre, les deux se répondent ;
l'effacement relatif des patronymes pour un il commun facilite
le passage de l'un à l'autre, Li Baï bien sûr n'est pas Kleist ni
inversement, mais enfin chacun pourrait l'être, c'est là affaire de
circonstances ; lisons-les. Li Baï et Kleist et pas qu'eux, car
d'autres artistes, pas musiciens pour rien ceux-là, viennent faire
résonner de leurs destins les destins des deux principaux
protagonistes, suggérant par là même au lecteur, en tout cas à
moi et après tout j'en suis un, une figuration de l'infini : en
effet d'autres destins, une infinité à l'évidence, pourrait venir
à leur tour faire écho et contrepoint à ceux déjà évoqués, et
ça n'est sans doute pas pour rien que, malgré la mort au bout de la
vie, le livre de Didier se refuse à finir, voici qu'après sa fin
viennent des notes qui n'en sont pas et qui le poursuivent de
l'intérieur, puis des « dettes » en guise de
remerciements aux livres qui ont nourri le travail de mon érudit
ami, on n'a pas fini de lire ; et je repense à l'Ironie du sort, dont je disais plus haut que c'était un virage, en effet,
c'est le moment où Didier da Silva a décidé de ne parler non pas de
tout ce qui existe, mais, moins modestement, de faire sa fête à
l'infini.
PS : Je m'avise que
Toutes les pierres ne paraîtra (sous une belle couverture de François Matton) aux éditions de l'Arbre
vengeur que le 5 avril prochain. Vous êtes déjà sur les braises.
Pardonnez-moi de m'en réjouir.