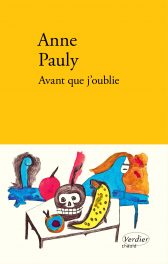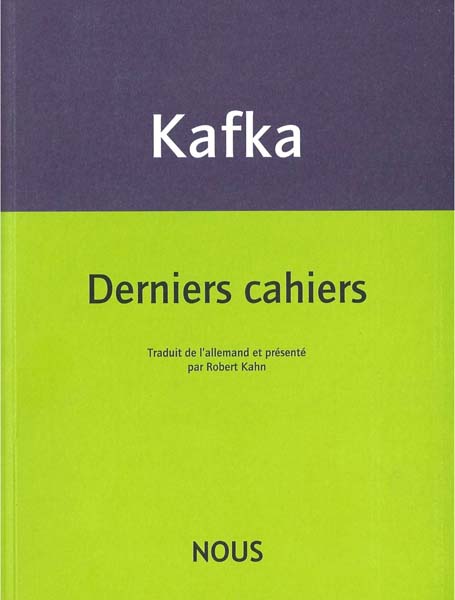J’ai enfin lu le livre d’Anne Pauly, Avant que j’oublie. Je ne
vais pas être très long. Le sujet est universel, la mort du père,
et singulier, c’est la mort du sien, à nul autre pareil
évidemment, il suffit de penser à celui qu’on a aussi. Car le
narrateur est Anne Pauly et ne fait pas mine d’autre chose. C’est
écrit sans esbroufes, ça évoque autant que ça raconte. Ça ne va
pas comme on voudrait, forcément, comment pourrait-il en être
autrement. Et c’est drôle, quand même, souvent, même au pire
moment ; et ça donne envie de se prendre par l’épaule,
aussi, et de plus en plus tandis qu’on avance dans la lecture,
parce que quand même, merde, vous voyez ce que je veux dire, mais
oui vous voyez.
Bibliographie
▼
Interviews
▼
samedi 28 décembre 2019
dimanche 22 décembre 2019
Fårö Une nuit avec Ingmar Bergman
Une jeune femme, une petite fille la veille encore, débarque un
soir, à la nuit tombée, en étrangère, chez un vieil homme. Elle
s’appelle Joëlle Varenne, et même son nom est incompréhensible à
l’homme qu’elle prétend rencontrer.
– Joëlle.
– Was ?
– Joëlle.
– Yulie ?
Yulia ?
– No, Joëlle.
– Was dis namn ?!
Skriv it !
Même
son nom, mais d’abord sa présence, car le vieil homme est Ingmar
Bergman, au soir de sa vie, farouchement
retiré sur l’île de Fårö,
qui donne au livre
son titre. Elle est étudiante en cinéma, et elle est venue
rencontrer celui qui
ne reçoit plus personne. Il s’ensuit un dialogue d’abord de
quasi sourds, la barrière de la langue y aidant, car si les deux
parlent anglais, chacun parle son anglais qui n’a pas grand-chose
en commun avec l’anglais de l’autre, et cela
donne lieu à des échanges qui sont d’abord cocasses, vraiment,
avant de devenir émouvants
quand on commence à comprendre que
ce qui a amené la toute jeune Joëlle Varenne, vingt-deux ans à
l’époque, à rencontrer le cinéaste ermite, c’est
peut-être sans le savoir l’attente, dans cette circonstance
incredibole,
d’entendre son propre nom, et peut-être aussi l’injonction de
l’écrire.
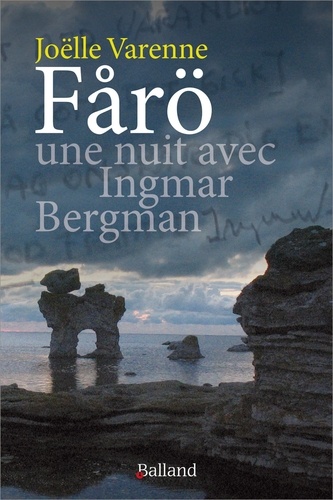
mardi 10 décembre 2019
Nuée de Gremeaux
Nuée, le nouveau livre de Michel Gremeaux, est une machine à
faire tourner l’imagination – la vôtre. Le narrateur nous montre
des choses, nous montre ce qu’il veut, ou ce qu’il peut, de loin,
de ce qui se passe aux abords et à l’intérieur d’une demeure
retirée au-dessus d’un lac. On y voit une femme recueillir une
adolescente, une blessure trop bien dessinée sur une cuisse, la même
sur un jean, une surveillance autour de la maison, plusieurs
surveillances peut-être, une attention extrême portée aux objets,
aux personnes qui passent, qu’elles fassent ou non vraiment partie
de l’histoire que le lecteur est en train de construire, presque
tout seul, avec ce qui lui est donné, avec le même plaisir qu’il
avait enfant à assembler des blocs géométriques pour bâtir des
architectures variées.
samedi 30 novembre 2019
Darmstadtium
Le Système poétique des éléments vient de paraître aux éditions
Invenit, regardez sous le lien. Il contient comme il se doit 118
éléments. J’en suis un.
lundi 18 novembre 2019
Écrase ma prune sur ton genou
– Écrase ma prune sur ton genou que son noyau au grand jour
paraisse, que mon jus à ton poil se lie.
–
Sois si près de mon œil des deux yeux fondus, prends la plus longue
lèvre, trouve ce que la gousse cache de grains, dis-m’en le
nombre.
–
Garde mon sein dans ta main, suce l’autre dans ta bouche, tiens les
deux, lèves-en un, suce l’autre.
–
Fends ma figue du tranchant de ta main que la partie gauche de la
droite s’écarte, que dans l’écart l’ergot darde.
–
Sois en moi, passe l’os, dis bonjour à ma pondeuse, dis coucou à
mon œuf, il se cassera demain.
–
Ramone ma moelle jusqu’à la tête, porte en avant puis en arrière
pour mieux avancer comme fait la grande balançoire.
–
A califourchon j’irai plus vite, demain sur ton genou poilu,
cheval, à cheval sur ton dos et mes lèvres à la pointe de tes
vertèbres, j’irai plus vite.
Gruche
copule avec Matelin et cela fait de nombreux Gruche-Matelin dont une
branche donne des académiciens et des régisseurs et une autre des
coquins et des maquerelles à profusion, certains muets ou sourds et
d’autres aphasiques ou apraxiques. Mignon se lie avec Uranie, une
Uranie-Mignon est alpiniste dans les massifs rocheux de Ligurie. Une
Flambonne-Ivry eut quinze fois en vingt ans douzaine de garçons qui
forment à présent des bandes de cambrioleurs-violeurs portant son
nom de jeune fille et sévissant en Russie dans la province de
Krasnoïark…
et
les familles s’organisent, le père parle au chien…
–
Merde puante, insiste-t-il sur chaque consonne, donne-moi donc ton
glaive, frère humain, merde puante, donne-moi donc ton glaive, que
je tranche de ma dextre la tête du serpent, donne-moi mes cisailles,
frère humain, qu’enfin je me sépare de ses œufs et que la
douleur m’envoie au ciel comme pétard d’artifice. Ah, malheureux
que je suis ! Les potiers ne font plus de ces grands canthares,
mais de petits et de bien polis, comme si c’était le vase et non
le vin qu’on dut avaler.
Eugène
Savitzkaya, Ode au paillasson, « Peuples
périssables », éditions Le Cadran ligné, 2019.
samedi 16 novembre 2019
(Mon) enfance de la littérature
Alors dans la série Enfance de la littérature, j’ai été
interviewé sur Radio Ritournelle pour parler de mon enfance de la
littérature. C’est un sujet qui m’intéresse, j’ai deux ou
trois choses à dire dessus, et même à raconter. On peut m’écouter
en cliquant sur ce lien :
Et
demain dimanche, je serai toute la journée au Salon desEssarts-le-roi (à la salle polyvalente de la mairie, rue du 11
novembre), avec quelques-uns de mes titres.
dimanche 10 novembre 2019
Il faut bien que les gens vivent.
En phrases décousues, nous avons expliqué que les travaux causaient
beaucoup de bruit et de poussière, il fallait voir notre jardin, on
était complètement envahis, ce n’était pas possible.
–
On termine demain, a répondu Arnaud sur le ton cordial dont il ne se
départait jamais, après on nettoie tout.
C’était
un bon commerçant. Il savait amadouer la clientèle. Puis Annabelle
a renchéri :
–
Il faut bien que les gens vivent. Si vous aviez eu des enfants, vous
sauriez ce que c’est que la vie.
J’ai
songé à la fraction identique d’humanité et, de moi-même, je
l’ai mise sur le compte de mon imagination. Un brouillard se
formait devant mes yeux. Ce devait être la faim, la fatigue. Je ne
me sentais plus très bien lorsque, à travers une épaisseur de
coton, je t’ai entendu menacer :
–
Écoute-moi bien, salope : soit tu te calmes, soit c’est moi
qui vais te calmer.
Les
Lecoq n’ont pas bronché. Ils nous ont toisés. Un léger sourire
de mépris ou d’autre chose a flotté sur les lèvres d’Arnaud.
Et très lentement il a refermé la porte, la retenant une dernière
seconde avant de la claquer sous notre nez.
Julia
Deck, Propriété privée, Minuit, 2019.
jeudi 7 novembre 2019
Dans la nuit du 4 au 15, je demande le 7.
« Evidemment, c’est une question de verre à moitié vide ou
plein, on n’en a jamais fini avec cette vaisselle : le
calendrier aussi bien est une maternité à ciel ouvert, une infinie
couveuse, trois cents pipettes pleines de gamètes, une ode à la
sève.
Prenez
le 7 novembre : certes, décanillent Steve McQueen (son cœur
s’arrête dans son sommeil, en 1980, au Mexique), Lawrence Durrell
(même chose dans le Gard, dix ans plus tard) et Leonard Cohen, mais
regardez un peu qui rapplique, que des cadors : un mystique
maniériste, Zurbaran, un navigateur intrépide, James Cook, un
magicien ès lettres Villiers de l’Isle-Adam, la radieuse Marie
Curie, cette tête de pioche de Léon Trotski, l’absurde Albert
Camus, n’en jetez plus, tout ce qu’il faut pour faire un monde »,
nous apprend Didier da Silva ; or à ce monde il manquait encore
un livre, que Quidam a résolu de faire paraître précisément le 7
novembre, mais 2019, l’année compte pour du beurre, écrit par ce
même Didier da Silva, « dans la nuit du 4 au 15 »
répondra-t-il à la récurrente question « quand
écrivez-vous ? », livre dont, sans aucun calcul, j’achève
à l’instant la lecture, en ce même 7 novembre 2019 encore,
ajoutant à cette date ma propre aventure de lecteur. Vous avez saisi
l’idée : depuis l’Ironie du sort (paru chez l’Arbre
vengeur en 2014), Didier da Silva attrape l’infini par un pan de sa
chemise, et tire dessus, pour voir.
dimanche 3 novembre 2019
Un libraire impromptu
Demain, c’est la rentrée. Je vais retrouver mes élèves, éternels
6e notamment depuis des années ; je ne vous dirai
pas combien. J’en parle rarement sur ce blog, dévolu à une autre
activité ; en effet il y a la plupart du temps, et je le
déplore, trop peu de relations entre l’enseignement du français
en collège et la littérature contemporaine. Il arrive pourtant que
les deux se croisent, et parfois de façon tout à fait impromptue –
on ne saurait mieux dire. Il s’est ouvert à l’hiver dernier, au
48 rue Sedaine dans le 11e arrondissement de Paris, une
librairie ainsi nommée que j’ai découverte il y a quelques
semaines à l’occasion d’une rencontre en l’honneur du
quarantième anniversaire des belles éditions Verdier. Or voici que
le maître des lieux et hôte de la rencontre me regarde avec
insistance, avec un sourire qui, mais oui, je connais ce visage, mais
bon sang, où donc ? avant de m’appeler « Monsieur
Annocque ». Or s’il arrive parfois qu’un libraire me
reconnaisse, c’est plutôt « Philippe Annocque » qu’il
interpelle. C’est que Jérémie Derny n’avait pas l’habitude de
m’appeler autrement lorsque, dans une autre vie, je fus son
professeur de français en 6e. C’était, avouons-le, il
y a plus de vingt ans, et pourtant je me rappelle parfaitement sa
bonne humeur sans faille et son enthousiasme, que m’avait annoncés
son grand frère que j’avais en classe l’année d’avant –
l’une de ces phrases qui se gravent dans la mémoire d’un
professeur. Cette bonne humeur et cet enthousiasme de Jérémie, il
est pour vous aussi maintenant, si vous passez par la rue Sedaine,
même le soir, par exemple jeudi prochain pour y écouter Sébastien Smirou et Yaël Pachet. Quant à moi, je le remercie de réconcilier
mes deux métiers, et souhaite un bel avenir à l’Impromptu.
samedi 26 octobre 2019
Henri Galeron dans mon oreille
Henri Galeron a été le très inspiré illustrateur de mon unique (à
ce jour) livre jeunesse. Dans une interview accordée à Axelle
Vianney, il revient sur cinquante années de travail durant
lesquelles il a illustré les auteurs les plus fameux, aussi ne
suis-je pas peu fier de la mention spéciale qu’il y fait de Dans
mon oreille (éditions Motus, 2013). C’est ici.
Pour l’anecdote, il m’avait confié que le poème ci-dessus était
celui qui lui avait été le plus difficile à illustrer. Je crois
que son dessin est celui que je préfère.
dimanche 20 octobre 2019
lundi 14 octobre 2019
Femmes animales
Femmes animales est je crois le premier livre de Laure
Belhassen et la toute dernière publication des éditions des Grands
Champs. Y sont recensées la plupart des métaphores animales
évoquant les femmes dans une langue qui est plutôt, il faut bien le
dire, celle des hommes. Il y a de quoi faire : tout un livre n’y
suffit pas puisqu’il y manque encore le chameau, seule lacune que
j’y ai trouvée. J’ai bien envie de vous en recopier un
échantillon mais comme je suis paresseux je me contenterai d’un
très léger, et qui vous vous en doutez n’est pas non plus le plus
vache (mais oui, elle y est aussi). Voici donc le colibri :
Dans les Caraïbes,
compliment adressé aux jolies femmes de 4 grammes passant leur vie à
butiner, se nourrissant de nectar et privilégiant la compagnie des
fleurs sans dédaigner celle des hommes.
Comme toujours chez les
Grands Champs le livre est joliment illustré, c’est un cadeau à
faire pourvu qu’on fasse attention où placer le marque-page.
samedi 5 octobre 2019
Le temps est à l’orage
J’ai lu Le temps est à l’orage, le nouveau roman de
Jérôme Lafargue. Une histoire de filiation, qui se passe maintenant
et autrefois, entre la forêt et la mer, dans ces Landes qui lui sont
chères. Je l’ai lu et maintenant j’attends la suite,
impatiemment. Car nul doute qu’il y en aura une.
lundi 23 septembre 2019
Adelphe a lu. Moi aussi.
Tiens j’ai lu un livre paru à cette rentrée. C’est Adelphe,
d’Isabelle Flaten, publié par le Nouvel Attila. C’est l’histoire
d’un homme qui a lu un livre qu’une femme lui a mis entre les
mains. C’est l’histoire d’un pasteur qui a des doutes. C’est
l’histoire d’un fils et c’est l’histoire d’un père. C’est
l’histoire d’un homme mais c’est surtout l’histoire des
femmes qui l’ont croisé. C’est l’histoire des amours qu’on
ne raconte pas. C’est l’histoire des libertés qui se
conquièrent. C’est un beau roman qui se lit avec quand même un
peu de larmes.
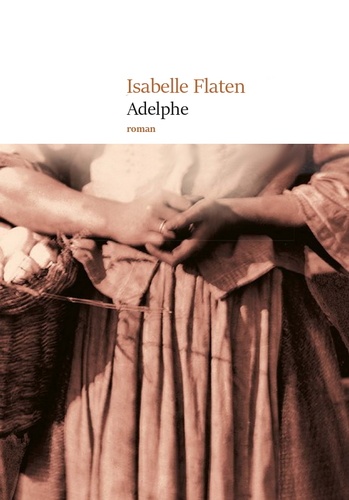
samedi 21 septembre 2019
Radieux
Marc Giai-Miniet est emboîteur. Il y a quelques années, j’ai
consacré un billet de ce blog à son travail ; voilà, c’est ici, cliquez.
Nous avons aussi fait
un livre, ensemble ; voyez donc.
Son univers m’évoque
irrésistiblement celui d’Antoine Volodine. Je le lui ai dit, il ne
connaissait pas encore.
En ce moment et pour un
mois environ, il expose ses boîtes à la Galerie Rauchfeld, 22 rue
de Seine, à Paris. J’en ai photographié une. Elle me réservait
une surprise.
samedi 14 septembre 2019
considération sur la lecture
Il arrive que des milliers de personnes lisent le même livre en même temps. C'est comme une vaste partouze, sauf que c'est quand même un peu dégoûtant.
mercredi 11 septembre 2019
fil en question
Je perds souvent le fil de mon propos. En cours, c’est un
problème ; les élèves me regardent et je ne sais plus ce que
je leur disais parce que déjà je leur dis autre chose. On me dit
que c’est parce que j’ai une pensée arborescente. Ça me fait
plaisir parce que j’aime les arbres. Et puis je regarde les fils de
mes écouteurs, que je suis en train d’essayer de démêler depuis
une bonne demi-heure. Heureusement que j’ai perdu mes cheveux, ça
me fait des nœuds en moins.
samedi 7 septembre 2019
et des désirs surhumains et les forces pour les réaliser
Il enleva son chapeau et sa chevelure se répandit comme si elle
était vivante, comme dans une abondance tropicale, en partie liée
en tresses, en partie dans sa sauvagerie originelle. Sa tête était
puissante, mais la masse de la chevelure était si grande qu’elle
semblait appartenir à une tête encore bien plus puissante, la tête
sous elle semblait petite. Mais en cela la vision n’avait rien de
ridicule, elle était surtout effrayante, c’était comme si cette
chevelure surhumaine exhibait et des désirs surhumains et les forces
pour les réaliser.
C’est un fragment des
Derniers cahiers de Kafka, publiés par les éditions Nous en
2017 et traduits par Robert Kahn.
mercredi 4 septembre 2019
A propos des rentrées d’Herbert
Tiens puisque c’est la rentrée littéraire, c’est peut-être
l’occasion de rappeler que Herbert Kahn, dont le roman Même la
nuit tombe dans ses bras est paru l’an dernier sous un titre
légèrement modifié par mes soins, rappelez-vous, avait déjà été
lui-même le protagoniste d’une ancienne rentrée littéraire, en
2001 aux éditions du Seuil ; il était tout jeune à l’époque,
pas même sorti de l’école et avec bien du mal à rentrer où que
ce soit, c’était bien là son problème. On en avait parlé un peu
dans la presse, cliquez donc, et si ça vous intéresse rappelez-vous que
Quidam a ressorti ce roman, dans une version retravaillée
par mes soins, et sous un titre déjà légèrement modifié ;
il ne faudrait pas que ça devienne une habitude.
samedi 31 août 2019
En pleine nuit au milieu de la forêt
En plein milieu de la nuit à 4h36 ils lui ont téléphoné pour lui
dire de ne pas s’inquiéter que sa mère était tombée alors il
est sorti à pied et il est allé en plein milieu de la forêt en
fait juste à l’orée mais il préfère dire en plein milieu mais
contrairement à la dernière fois il n’y avait rien dans la forêt.
En
plein milieu de la nuit, à 4h36, ils lui ont téléphoné pour lui
dire de ne pas s’inquiéter, que sa mère était tombée, alors il
est sorti à pied et il est allé en plein milieu de la forêt, en
fait juste à l’orée, mais il préfère dire en plein milieu,
mais, contrairement à la dernière fois, il n’y avait rien dans la
forêt.
4h36
est-ce que c’est en plein milieu de la nuit ? Le milieu de la
nuit ne le reste pas. Le temps d’arriver à l’orée de la forêt
il y avait déjà une vague lueur à l’est. C’est peut-être pour
ça qu’il n’y avait rien à l’orée de la forêt. Mais
peut-être qu’en plein milieu il y avait quelque chose.
Peut-être
qu’ils ne lui ont pas téléphoné pour lui dire de ne pas
s’inquiéter. Peut-être que dire de ne pas s’inquiéter est une
autre manière de dire de s’inquiéter.
Peut-être
qu’aller dans la forêt au milieu de la nuit est une autre manière
de s’inquiéter.
Peut-être
que la différence entre aller à l’orée ou en plein milieu de la
forêt change quelque chose à la manière dont on s’inquiète.
La
dernière fois il n’était pas 4h36. La dernière fois sa mère
n’était pas tombée. La dernière fois ils n’avaient pas
téléphoné. C’était la dernière fois mais ce n’était pas
vraiment la dernière fois. Ce n’était pas étonnant que ce soit
si différent dans la forêt.
Pourtant
c’était déjà l’orée. Oui, l’orée, au lieu du milieu. La
dernière fois il avait senti ses poils d’animal diurne se dresser.
Alors que cette fois, non. En pleine nuit à l’orée de la forêt,
il n’avait rien senti. En pleine nuit à l’orée de la forêt, en
plein milieu ça aurait été pareil, il pensait à sa mère qui
était tombée mais qui n’était pas blessée.
vendredi 30 août 2019
Billet de rentrée (4)
"Rentrée" est un terme ambigu. Par exemple, "rentrée littéraire" et "rentrée d'argent" sont deux choses différentes.
jeudi 29 août 2019
Billet de rentrée (3)
C'est la rentrée. Sortons ! se disent les livres. Tout le monde reprend le travail, personne n'aura le temps de nous lire ; on ne risque rien.
lundi 26 août 2019
Billet de rentrée (2)
- Pourquoi ne parlez-vous que des livres dont tout le monde parle ?
- C'est parce que sinon je risquerais de parler tout seul et ça me fait peur.
dimanche 25 août 2019
Billet de rentrée (1)
Ça y est, ça va être la saison où on va lire pour se faire "sa propre opinion".
mardi 9 juillet 2019
lundi 8 juillet 2019
Quelle comédie la vie
Quelle comédie la vie
Heureusement
j'ai choisi
le rôle du souffleur
Où est l'aube
Je ne vois
qu'un espace sans nom
dans le ciel qui hésite
Estelle Fenzy, La
Minute bleue de l'aube, éditions La Part commune, 2019.
mercredi 3 juillet 2019
mardi 2 juillet 2019
Billet furtif
Disons les choses
complètement dans le désordre. C'est un roman engagé. C'est un
roman sur l'amitié. C'est un roman d'aventures. C'est un roman sur
le langage. C'est un roman d'amour. C'est un roman expérimental.
C'est un roman populaire. C'est un roman à suspense. C'est un roman
sur la musique. C'est un roman de science-fiction. C'est un roman sur
la famille. C'est un roman choral. C'est un roman sur la vie. C'est
un roman presque oulipien par moment. C'est un roman sur la joie.
C'est un roman qui mériterait un long billet car c'est aussi un
roman qui pèse 985 grammes pour ne pas dire qu'il pèse un kilo. Le
nihiliste inavoué en moi va peut-être trouver que c'est un roman un
peu bisounarchiste sur les bords si l'on veut chipoter mais c'est un
roman tellement émouvant (et tout simplement passionnant) qu'on va
s'en abstenir. C'est un best-seller, une fois n'est pas coutume dans
mes lectures, et c'est bien mérité.
lundi 1 juillet 2019
vendredi 28 juin 2019
jeudi 27 juin 2019
mardi 25 juin 2019
lundi 24 juin 2019
dimanche 23 juin 2019
jeudi 20 juin 2019
mercredi 19 juin 2019
mardi 18 juin 2019
Brèves animales (13)
C’est quand les bois du
cerf tombent qu’il les quitte pour le désert dont deux dunes
désormais gonflent le dos de ce chameau.
lundi 17 juin 2019
dimanche 16 juin 2019
samedi 15 juin 2019
vendredi 14 juin 2019
jeudi 13 juin 2019
mercredi 12 juin 2019
Brèves animales (7)
Épris de simplicité, le
serpent serpente et le lézard lézarde tandis que, dans sa
maladroite et innocente tentative pour les imiter, le crocodile
croque Odile.
mardi 11 juin 2019
Brèves animales (6)
La rhamphothèque est le
tégument corné du bec, elle permet à l'oiseau d'oublier qu'il
tombe aussi sur un os lorsqu'il tombe sur un bec.
dimanche 9 juin 2019
Brèves animales (5)
Le bec du toucan est si
gros qu'au moins il sait que c'est surtout sur le sien qu'il risque
de tomber.
samedi 8 juin 2019
jeudi 6 juin 2019
mercredi 5 juin 2019
mardi 4 juin 2019
lundi 3 juin 2019
Petites nausées (5 et dernière)
(Vers Petites nausées 1, Petites nausées 2, Petites nausées 3, Petites nausées 4)

Cette
sensation m’est familière, si discrète qu’elle ait su se faire.
J’ai parlé des boutons (et autres petits objets à prendre entre
les doigts), j’ai parlé de Renoir ; en réalité, je pourrais
bien la retrouver ailleurs. Pour preuve : dès que j’imagine
de répertorier, de mettre en liste les causes diverses de mes
dégoûts irrationnels, une autre à l’instant se présente à mon
esprit, dans toute son écœurante évidence : mon prénom.
Là
encore, dire avec précision ce qui se passe n’est pas facile. Un
improbable lecteur se fourvoiera sans doute dans ses interprétations,
à cause de ma propre incapacité à discerner l’essentiel.
Mon
prénom est un prénom courant. Je suis même obligé de le
préciser : c’est un prénom vraiment très commun, tout au
moins dans ma génération ; il paraît même que ce fut le
prénom masculin le plus donné en France l’année de ma naissance.
Mais
déjà je regrette presque ces précisions, honnêtes, objectives
tout au moins, mais qui ne disent rien de ce que je ressens, et qui
risquent d’induire une fausse piste : prénom commun, trop
commun, qui n’est plus un nom propre, qui à la limite usurpe sa
majuscule, ne la mérite pas.
Il
ne s’agit pas de ça.
Il
ne s’agit pas davantage du prénom lui-même, de ses sonorités ;
pas davantage de quelque éventuel prédécesseur, qui l’aurait
porté avant moi et entaché d’une souillure indélébile ou
auréolé d’un prestige exorbitant. Non, disons les choses
clairement : que ce soit « Philippe » n’a rien à
voir là-dedans. Je ne trouve pas ce prénom plus vilain qu’un
autre. Ç’aurait été Patrick ou Alain ou Eric, ç’aurait été
exactement pareil.
En
réalité, ce n’est pas vraiment « Philippe » ;
c’est juste que moi, je sois « Philippe ». C’est
un peu comme si j’étais obligé de porter des vêtements
d’emprunt. (J’ai toujours détesté enfiler des vêtements
d’emprunt. Dégoût, encore. D’autres, j’imagine, me
comprendront.) « Philippe », ce n’est pas moi. Parfois,
dans la conversation, il arrive qu’on m’appelle « Philippe »,
sans que ce soit vraiment nécessaire ; qu’on utilise ce mot
un peu à la manière d’un signe de ponctuation. « Ne
m’appelez pas « Philippe », suis-je alors tenté de
dire à mon interlocuteur. » Mais lui, forcément :
« Comment voulez-vous que je vous appelle ? Vous vous
appelez bien Philippe ! » « Ne m’appelez pas. »
Ce
serait inconvenant, je m’en rends bien compte. C’est pourquoi, la
plupart du temps, je me laisse appeler « Philippe ».
Qu’en
dire ? Il me semble, mais je peux me tromper, que les choses
auraient été atténuées, non pas annulées mais simplement
atténuées si mon prénom avait été plus court (plus proche de
rien) ; et qu’elles auraient été aggravées s’il
avait été plus long. Mais je n’en suis pas sûr. Ou plutôt :
il y a sûrement du vrai là-dedans, mais les choses ne sont pas si
simples.
Parfois,
souvent même, je dois le reconnaître, « Philippe »
passe inaperçu. Pour peu que son emploi soit vraiment justifié,
indiscutable, je ne le remarque plus. Ce n’est qu’en forçant ma
mémoire que je me rends compte que tiens ! on m’a appelé
« Philippe », et que, curieusement, je n’ai pas
bronché. Comme, évidemment, il est rare que je force ma mémoire
sur ce sujet ; il est très probable que de nombreux
« Philippe » passent ainsi à l’oubliette, comme les
boutons de ma braguette ou les reproductions des peintures de Renoir
dans les manuels scolaires.
Mais
d’autres fois – les fois qui comptent –, au moment où,
effectivement, on m’appelle « Philippe », je me sens
appelé « Philippe ». Et voilà, je dois donc être
« Philippe » ! je dois incarner
« Philippe » ! Je n’en ai pas le choix, on vient
de me sommer de l’être. Je n’ai plus qu’à me conformer :
« Philippe », c’est moi.

dimanche 2 juin 2019
Petites nausées (4)
(Vers Petites nausées 1, Petites nausées 2, Petites nausées 3)
Mais c’est donc que, dans les deux cas, face au bouton, face au tableau de Renoir, je suis tenté de penser à quelque chose (quelque chose à quoi les autres, a priori, ne penseraient pas), que seule la volonté m’a appris à occulter.

Mais c’est donc que, dans les deux cas, face au bouton, face au tableau de Renoir, je suis tenté de penser à quelque chose (quelque chose à quoi les autres, a priori, ne penseraient pas), que seule la volonté m’a appris à occulter.
Face
au bouton, il y a cette conscience nauséeuse qu’il s’agit d’un
objet manufacturé, de petite taille, destiné à être pris
entre les doigts.
Face
au tableau de Renoir, cette espèce de flou fuyant écœurant, de
flou en mouvement (mouvements contradictoires, quasi tiraillement ;
mais ce n’est pas cela, non vraiment ce n’est pas cela) ;
cela même qui me permet de reconnaître à coup sûr Renoir –
et de n’éprouver aucune répulsion devant l’œuvre médiocre
d’un pâle imitateur.
Peut-être
faut-il dire aussi (j’en suis moins certain, mais tout de même je
le dis, par honnêteté : parce qu’on ne sait jamais)
que le bouton, aussi, par sa petite taille, est susceptible d’être
improprement porté à la bouche, notamment par un jeune
enfant.
Le
mal nommé flou fuyant de Renoir me suggère peut-être avec trop de
violence que les choses ne peuvent pas demeurer en l’état. (Mais
pourquoi seulement le flou de Renoir ? Peut-être les sujets des
tableaux ont-ils plus d’importance que je ne veux bien leur
accorder.)
Dans
les deux cas, un unique réflexe (heureusement stoppé par les effets
d’une bonne éducation) : vomir.
Vomir,
j’imagine, est un réflexe de défense de l’organisme, qui se
débarrasse par le chemin le plus direct de ce qui le met en péril.
Nul doute qu’il y a, dans les peintures de Renoir, comme dans les
petits objets manufacturés, quelque chose qui me menace. (J’allais
écrire : « qui menace ma santé ». Ça n’aurait
pas de sens. J’ai vu suffisamment de tableaux de Renoir, j’ai
ramassé suffisamment de boutons pour savoir que ce n’est pas ma
santé physique qui est menacée.)

samedi 1 juin 2019
Petites nausées (3)
(Vers Petites nausées 1 et Petites nausées 2)
C’est
plutôt de l’écœurement. Fugitivement, face au bouton (surtout si
je suis obligé de m’en saisir), face à la peinture de Renoir, ce
qui me prend – sans toutefois aboutir –, c’est une envie de
vomir.
Rien
à voir avec le sujet du tableau ! Ce n’est pas dans ce qu’il
représente qu’il faut chercher la source de l’écœurement. Elle
est plutôt dans ce qui fait que l’on reconnaît que c’est un
« Renoir » (d’aucuns diraient la patte, la main, la
manière ; mais je ne crois pas que cela ait à voir avec les
mains).
Pourtant,
si j’y pense, pour le bouton ; contrairement au tableau, ce
qu’il représente compte. Si le bouton, arraché (ou neuf, non
encore cousu ; pour moi, cela revient au même) n’en était
pas un ; si c’était un objet véritablement tout autre ;
surtout, si c’était un produit de la nature : une graine, un
caillou auquel le hasard aurait donné l’apparence approximative
d’un bouton – dans ce cas alors je crois, j’ose penser qu’il
n’y aurait pas chez moi la moindre trace d’écœurement. Je
n’aurais pas besoin de lutter contre, comme je le fais depuis si
longtemps (au point que je suis devenu aujourd’hui en réalité
tout à fait capable – au prix d’un effort prolongé de ma
volonté – de mettre une chemise et d’aller visiter – je dirais
même d’apprécier – une exposition Renoir). Je n’y
penserais pas.
Bien
sûr je m’embrouille. Un bouton ne « représente » pas
au sens où un tableau « représente ». Là n’est pas
sa fonction.
Mais
c’est donc que, dans les deux cas, face au bouton, face au tableau
de Renoir, je suis tenté de penser à quelque chose (quelque chose à
quoi les autres, a priori, ne penseraient pas), que seule la volonté
m’a appris à occulter.

mardi 28 mai 2019
Petites nausées (2)
Comment
donc se fait-il que, contraint chaque matin de manipuler les
inévitables boutons qui me restent (au moins celui de ma braguette),
rien ne vient m’empêcher ? Que se passe-t-il qui me vaut
cette apparente libération ? Le même travail intérieur sans
doute (mais remontant à un temps bien plus ancien, dont j’ai perdu
la mémoire) que celui qui encore a lieu (mais de moins en moins, à
force) face à un tableau de Renoir, maintenant que je parviens à la
maturité – la maturité qui me permet, non sans peine, de faire
face au tableau de Renoir.
Plus
jeune, vers l’adolescence, je disais que je n’aimais pas Renoir.
On s’étonnait. On me demandait pourquoi. Je ne savais pas trop
quoi répondre. Parfois, poussé dans mes derniers retranchements, je
disais juste « C’est flou. » Puis j’ai renoncé à
cet argument, qui ne convainquait pas mes interlocuteurs, et que je
trouvais moi-même bien insuffisant – quoique sincère. D’ailleurs
j’aimais Monet. Je restais fasciné devant des esquisses de Turner.
Et puis je n’ai jamais rien eu à reprocher au flou en général,
je n’ai jamais rien eu ni contre ni pour le flou.
Je
savais bien au fond de moi que ce « je n’aime pas Renoir »,
qui choquait tout le monde, ne disait pas ce qu’il y avait à dire.
Il était d’ailleurs bien faible, par rapport à ce que j’éprouvais
vraiment. Ce que j’éprouvais vraiment, c’était plutôt de la
répulsion, du dégoût. On n’éprouve pas, me semble-t-il, de la
répulsion pour les œuvres qu’on n’aime pas. (Il y a des œuvres,
des choses en général que je n’aime pas ; et rares sont
celles qui me provoquent, à proprement parler, de la répulsion). Et
cette répulsion, maintenant que j’y pense, est du même ordre que
celle que j’éprouve entre autres pour les boutons arrachés de la
chemise (surtout s’ils sont petits et vaguement nacrés, tels qu’on
les voit si souvent.) Et honnêtement, dire que « je n’aime
pas » les boutons de chemise ; non, vraiment, ça n’aurait
pas de sens.

lundi 27 mai 2019
Petites nausées (1)
Qu’un
bouton s’arrache de ma veste, j’aurais peine à le ramasser. Pire
encore si c’est de ma chemise. (Et pourtant rien de plus
désagréable qu’un vêtement auquel manque un bouton !)
Pour
peu qu’il ne m’appartienne pas et que je ne sois pas seul au
moment de sa découverte, je souhaite à toute force qu’un autre le
ramasse. Sinon, le plus souvent, je fais celui qui n’a rien vu.
Ainsi
en est-il aussi des tout petits jouets d’enfants (d’autant plus
s’ils portent des traces d’usure), pièces de jeux, fèves de
galette des rois.
Mais
les boutons, je suis bien contraint d’y toucher au moins quand,
bien cousus, ils remplissent leur office. (Cela dit, le cas se fait
plus rare. Les gens qui me connaissent me voient rarement en veste,
encore moins en chemise. Je préfère – quoique non sans réserve,
à cause de la languette à tirer – les fermetures éclair. Rien de
tel en final que les t-shirts, les sweat-shirts.)
Comment
donc se fait-il que, contraint chaque matin de manipuler les
inévitables boutons qui me restent (au moins celui de ma braguette),
rien ne vient m’empêcher ? Que se passe-t-il qui me vaut
cette apparente libération ?
(A suivre)

vendredi 24 mai 2019
Ce qui pour Claire ne l'est pas
Un cadenas sur le cœur
est le premier roman de Laurence Teper, dont j'ai beaucoup aimé le
travail d'éditrice. Et j'aime aussi beaucoup ce roman, récemment
paru chez Quidam.
L'héroïne s'appelle
Claire, et rien n'est clair pour elle qui ne voit pas ce qui pour
tout le monde, même pour le lecteur à qui pourtant on ne le dit
pas, est clair dès le départ. Il y a des choses qui sont en
évidence sous notre nez et que nous ne voyons pas. Il y a des choses
qui sont en évidence sous notre nez et que nous sommes conditionnés
pour ne pas voir. Et ça peut faire du mal. C'est tragique, Un
cadenas sur le cœur ;
le titre le dit bien. Ce qu'il ne dit pas, c'est que cette histoire
triste à pleurer, Laurence Teper a trouvé un ton pour la raconter
qui parvient à tirer un sourire au lecteur, un rire parfois.